LES MESURES ANCIENNES ET LE METRE.
Dans cet article, je me pose des questions sur la capacité du monde scientifique à accepter des évidences à partir de mesures reproductibles sur des éléments architecturaux antiques. Se pourrait-il que le mètre y ait quelques évidences lui aussi ?
Jean Pierre Segonnes
8/20/20244 min read
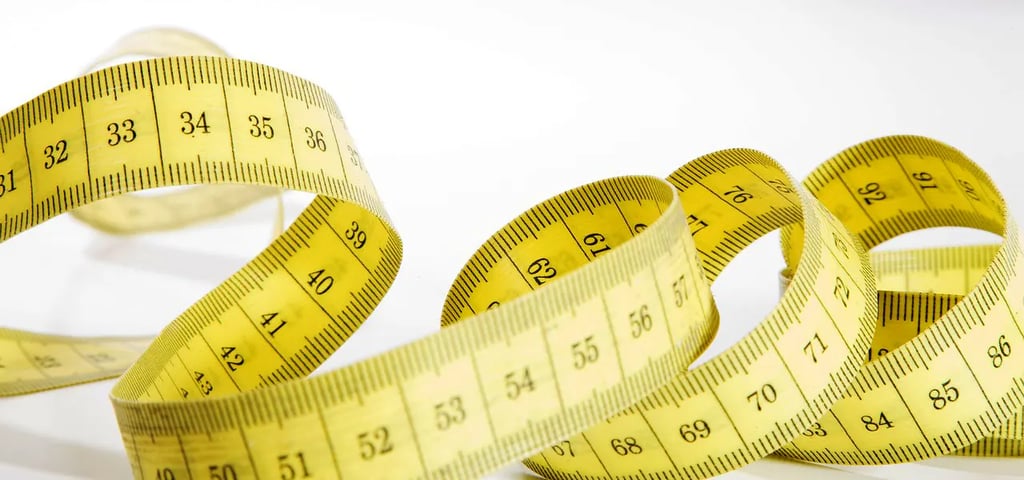

Voilà bien une question complexe qui touche à des concepts fondamentaux en épistémologie et en logique. L'absence de preuve testimoniale en archéologie, ou de toute preuve en général, est souvent évoquée dans les débats entre amateurs et scientifiques pour discuter par exemple de la non-connaissance de l’unité métrique par les anciennes civilisations. Cette question peut être examinée sous plusieurs angles :
1. Le principe du fardeau de la preuve :
- En logique et en droit, le fardeau de la preuve incombe généralement à la personne qui affirme l'existence de quelque chose. Si quelqu'un fait une affirmation, il doit en fournir la preuve. Si aucune preuve n'est apportée, on ne peut pas conclure que la chose existe.
- Cependant, l'absence de preuve n'est pas en soi une preuve de l'absence. Ce n'est pas parce que nous ne disposons pas de preuve testimoniale que quelque chose n'existe pas ou n'a pas existé.
- Les querelles viennent donc d’un handicap de la pensée humaine qui cherche un raisonnement en vrai ou en faux, en excluant la probabilité.
2. L’argument du silence :
- L'argument du silence (ou argumentum ex silentio) est une forme d'argument où l'absence de témoignage ou de preuve directe est utilisée pour suggérer que quelque chose n'a pas eu lieu. Cet argument est souvent considéré comme faible, car le silence ou l'absence de preuve peut avoir plusieurs explications autres que la non-existence, par exemple la disparition du témoin exclusif ou la nécessité d’une technologie plus avancée pour étudier un phénomène physique observable, mais incompris.
- Cependant, dans certains contextes, l'absence de témoignage peut être significative, surtout si on s'attendrait logiquement à ce qu'il y ait des témoignages ou des preuves. Par exemple, si un événement historique majeur était censé se produire, mais qu'aucune source contemporaine n'en fait mention, cela peut suggérer que l'événement n'a peut-être pas eu lieu, mais ça ne sera jamais une certitude.
3. Le principe de parcimonie (rasoir d'Ockham) :
- Le rasoir d'Ockham suggère que parmi les hypothèses concurrentes, celle qui fait le moins d’assomptions devrait être privilégiée. Ainsi, en l'absence de preuves testimoniales ou de toute autre forme de preuve, il pourrait être plus rationnel de ne pas supposer l'existence de quelque chose. Or, le propre et la richesse de la pensée humaine sont bien d’imaginer l’inimaginable.
4. Sciences et absence de preuve :
- En sciences, l'absence de preuve n'est jamais considérée comme une preuve définitive de non-existence, sauf par des extrémistes qui refusent de changer de dogmatisme. Cela peut indiquer une limite dans les méthodes de détection actuelles ou dans notre compréhension du phénomène. Par exemple, l'absence de preuves de vie extraterrestre ne prouve pas que la vie extraterrestre n'existe pas ; cela peut simplement refléter les limites de nos technologies et de notre capacité à détecter de telles formes de vie.
5. Et l’unité métrique dans tout ça ?
- Les archéologues argumentent avec raison que nous n’avons aucune règle antique graduée en mètre, centimètres ou millimètres. Par contre nous avons effectivement les preuves que les anciens ont utilisées beaucoup de façons différentes d’effectuer des mesures en se référant à des termes tels que le pied, la coudée, le doigt, etc.
- Le principe primordial des sciences est l’observation. On pourrait donc s’attendre à ce que tout le monde convienne d’une observation simple et mesurable à souhait. Il en va ainsi de la fameuse chambre du roi dans la pyramide de Khéops en Égypte.
- L’ennui vient d’un postulat de départ selon lequel les anciens auraient souhaité dimensionner l’intérieur de la pièce en nombres entiers d’une valeur étalon, en l’occurrence la coudée royale égyptienne. Si plus personne ne conteste son existence, les querelles viennent de la preuve sur son origine et la façon de la définir à l’aide d’une valeur étalon entre 52 et 54 cm.
6. Ce que j’en pense.
- Puisque personne ne s’accorde sur la coudée royale et le mètre, j’ai voulu regarder ce qu’on peut observer dans l’antique Sumer et la fameuse ziggourat d’Ur (voir mon article sur les ziggourats). Sa base est donnée d’une façon précise à 43 m par 62,5 m. La coudée de Nippur, dont une règle de bronze est exposée au musée d’Istanbul, est donnée à 0,5184 m, ce que certains historiens mal intentionnés semblent ignorer.
- Voyons ce que donne une évidence : Si nous calculons la surface de la base de la ziggourat cela donne : 43 x 62,5 = 2687,5 m². Prenons maintenant la racine carrée de ce nombre pour en déduire la longueur des côtés d’un carré qui donnerait exactement la même surface, on obtient : Racine carrée de 2687,5 = 51,8411 m. Et vous en conviendrez avec moi cette longueur n’est pas très différente de 100 fois la coudée de Sumer de 0,5184 m.
- Peut-on en déduire que les Sumériens l’on fait exprès ? Ce qui est certain, c’est que ni 43, ni 62,5 ne sont des multiples en valeur exacte de cette coudée. La question reste donc comment ont-ils choisi les valeurs des côtés en mètres, s’ils ne connaissaient pas un étalon qu’on pourrait appeler le mètre justement ?
- Dans le prochain ouvrage que je publierai sur mes recherches au Moyen-Orient, je démontrerai que les architectes utilisaient la coudée de Nippur en tant que grandeur physique déduite d’une grandeur reconnue aujourd’hui et que les gens de ces époques lointaines n’auraient pas dû connaître, et pourtant ils la connaissaient manifestement, soit parce qu’ils l’avaient déduite, soit parce qu’on leur avait donné..
Conclusion :
L'absence de preuve testimoniale peut suggérer que quelque chose n'existe pas ou n'a pas existé, surtout dans un contexte où on s'attendrait à ce qu'il y ait des témoignages.
Cependant, cette absence n'est pas une preuve de la non-existence. En général, il est plus prudent de considérer que l'absence de preuve ne prouve pas nécessairement l'absence, tout en restant attentif aux contextes spécifiques où ce silence pourrait être significatif.
L’ABSENCE DE PREUVE EST-ELLE LA PREUVE DE L’ABSENCE ?
© 2024. Tous droits réservés